Témoigner des apports d’Edgar Morin dans la conduite de ma vie d’entrepreneur est un défi épistémologique ! Traduire quelles actions, quelles prises de conscience, quelles stratégies m’ont été inspirées par ses écrits est difficile ! D’autant que ma lecture tardive (vers 40 ans) de Morin est venue se rajouter aux autres domaines que j’approfondissais depuis de nombreuses années ! Le plaisir est d’autant plus grand de vous faire partager cette expérience !
Les domaines de connaissances avec lesquels je vis au quotidien sont d’un côté ceux de la conduite d’entreprise et de l’économie de marché, et de l’autre ceux de la botanique et de l’écologie. La philosophie, quant à elle, m’a accompagné tout au long de ma vie, et me permet de commenter philosophiquement ces deux domaines d’actions, entre autres.
En effet, a lecture d’Edgar Morin a modifié substantiellement ma manière d’interpréter ces connaissances. En me permettant de concevoir la complexité, il m’a donné des clés et esquissé une méthode de modélisation des systèmes. Un nouveau mode de compréhension m’est apparu, cherchant la synthèse plutôt que l’analyse, le méta-point de vue plutôt que le détail. Il m’a également appris que tout phénomène, tout échange, doit être contextualisé dans l’environnement dans lesquels il se déroule, en observant la qualité des relations et les interférences existant avec les parties prenantes.
Ses principes m’ont guidé dans ma compréhension du monde, en mettant des mots, en décrivant des modèles relationnels dont je voyais l’existence sans savoir les formaliser.
Dans mon rôle de chef d’entreprise, cette nouvelle conscience de la complexité m’a permis de voir de nombreux systèmes cohérents de relations, dans et autour de l’entreprise. Ils sont devenus petit à petit évidents. D’une part l’entreprise-système est complexe, car les services sont en interaction interne. D’autre part l’entreprise existe elle-même dans un écosystème économique et social. Systèmes et écosystèmes sont entremêlés, en interaction permanente.
Lors du développement de mon entreprise et de la construction de l’organisation des services, ces clés m’ont grandement aidé à modéliser.
J’ai donc choisi de vous présenter les concepts les plus marquants et en quoi ils m’ont servi dans cette mission. Je les ai regroupés selon deux axes, conformément à ma vision : l’entreprise est un système cohérent d’humains agissant à l’intérieur d’un écosystème économique et social :
- L’entreprise système
- La dynamique des relations humaines
- L’entreprise dans son écosystème économique
Mon modèle d’écosystème : la nature
J’ai vécu dans la nature ma première approche du système, à travers la compréhension et la modélisation des interférences entre les êtres vivants dans les écosystèmes et les biotopes. La vision kaléidoscopique du système que Morin (1 ; p 28) présente m’a permis de construire le parallèle entre mon entreprise dans la société et un être vivant dans un biotope. Naturellement, les biotopes-écosystèmes sont constitués d’une multitude d’êtres vivants (plantes et animaux) qui interagissent entre eux dans un espace défini. La stabilité du système est garantie par la diversité de ces interactions. Mon entreprise interagit avec l’environnement économique dans lequel elle se développe. Elle est une partie active de la société. Elle intervient comme un être vivant dans un biotope, en le construisant et en échangeant avec ses parties prenantes.
Un parallèle équivalent peut être fait entre l’individu et l’entreprise, ou la société, à laquelle il appartient. Il en est un acteur constitutif, et échange avec ses pairs des informations et des biens. L’entreprise -organisation est un écosystème pour les sujets qui la constituent.
Dans le cadre de la construction de mon entreprise, je me suis servi de ce modèle pour veiller à gérer les flux de matières et d’informations entre les services.
Construire une organisation complexe
Les entreprises sont parfois réduites, par une vision simpliste, à des machines à profit. Ceux qui ont vécu cette condition de chef d’entreprise savent que cette image est très loin de la réalité, le profit n’arrivant que si tout va bien. Le défi du chef d’entreprise est de faire en sorte que tout aille bien : des clients suffisamment nombreux, une équipe de production motivée, une bonne gestion financière, tout en respectant toutes les règles imposées et archi compliquées à tous les niveaux. Pour ma part, en rachetant notre petite affaire familiale de recyclage d’une quinzaine de personnes au début des années 90, mon intérêt s’est porté sur :
- La survie de l’identité, notamment d’un point de vue financier en cherchant de nouveaux clients pour nourrir l’entreprise
- La structuration des fonctions essentielles vitales : contrôle de l’évolution pour s’auto-évaluer, gestion des investissements pour savoir croître et se régénérer
- La recherche de personnes pour constituer des équipes opérationnelles
- La diversification de nos produits pour se garantir une bonne adaptabilité aux marchés très fluctuants des matières premières.
Petit à petit, des fonctions transversales se sont mises en place, et certains départements ont au contraire cheminé vers plus de spécifications. Le nombre de service est passé de 3 à plus de 25. Tout ce monde en interférence multiples, internes et externes, est une des images de la complexité et du système ouvert que je porte avec moi.
Si la lecture de Morin ne m’a pas amené de clés directement applicables pour résoudre les problèmes que je rencontrais, j’ai compris que la problématique était complexe et que la pensée simplificatrice, cartésienne, rationalisante, était d’une efficacité limitée pour la nature de ce problème : « l’hyper-simplification rend aveugle à la complexité du réel » (1 ; p28).
Je me suis alors consacré à construire des schémas témoignant des relations existantes entre les services, pour commencer à aborder cette complexité. Chaque service remplit une des fonctions nécessaires à l’entreprise : certains travaillent au fonctionnement interne de l’organisation, d’autres sourcent du business dans notre environnement, de la nourriture pour notre système.
L’auto-organisation
Le modèle d’entreprise que j’avais appris de mon père reposait, comme dans beaucoup de petites entreprises, entièrement sur le patron qui sait tout, décide de tout, incarne l’entité. Il est la figure de proue du système.
Mais le développement rapide m’a fait cheminer vers les limites du modèle. La construction que j’avais moi-même mis en place s’est finalement beaucoup trop complexifiée ! Je n’étais plus capable de construire chaque échelon du puzzle. Il fallait identifier les nouvelles fonctions nécessaires au système, les penser, les concevoir. Puis les analyser, synthétiser les besoins, pour construire un service. Ayant un peu perdu la main mise sur tous les services, force a été de constater que certains services avaient émergés. Les personnes touchées par une carence du système dans un certain domaine s’étaient organisées pour que la fonction qui manquait soit opérationnelle. Travaillant de plus en plus souvent ensemble, une équipe se crée de fait. De cette émergence naît un nouveau service. Ici apparait de manière évidente l’auto-organisation.
Edgar Morin nous dit : « l’entreprise, organisme vivant, s’auto-organise, et fait (…) de l’auto-éco-organisation et de l’auto-éco-production » (1 ; p116).
Un autre domaine dans lequel l’auto-organisation m’est apparu est celui du marché des métaux recyclés : sur un territoire donné, une fonderie de bronze a besoin de matière première : de vieilles pièces en bronze. À ceux qui lui en apporte, elle achète un bon prix le métal. Les quelques personnes qui sont informés de cela ont tout intérêt à chercher partout des pièces de ce métal, pour les revendre et financer leur existence. Ces intermédiaires proposent de l’acheter à ceux qui en détiennent, et font une marge vitale sur cette opération. C’est parce que le commerçant gagne de l’argent que cette fonction sociétale existe. Un système de drainage du bronze sur le territoire se met en place, permettant à la fonction fonderie de bronze d’exister. Ce marché s’est auto-organisé pour satisfaire un besoin d’auto-production.
L’autopoïèse
« Les structures restent les mêmes bien que les constituants soient changeants » (1 ; p 31). Nos organisations humaines, mais plus encore nos corps constitués de cellules sont soumis à une règle : l’autopoïèse. Il est nécessaire de renouveler les parties dégénérantes de nos tissus par de nouveaux constituants. Cela se fait sans changer l’identité du système. Dans le cadre de l’entreprise, un comptable, un chauffeur de camion peuvent partir, leur départ ne changera pas l’identité de l’entreprise. Ils seront remplacés par d’autres personnes qui viendront remplir leur rôle et constituer, à leur tour, l’identité de l’entreprise. A une autre échelle, il en est de même pour l’entreprise dans le cadre de sa mission sociétale, qui, si elle ne satisfait plus ses clients, est remplacée par une autre sans changer le fonctionnement de la société.
Dans le prolongement de la prise de conscience de l’autopoïèse, j’ai porté ma vigilance sur l’obligation de se régénérer. « Tout ce qui ne se régénère pas dégénère. » Ce message très important à mes yeux oblige à ne pas s’endormir sur des acquis de réussite. Au-delà du simple maintien de l’organisme que suggère l’autopoïèse, la régénération propose également la réadaptation. Pour exister, l’entreprise doit en permanence remettre en question ses croyances : le monde autour d’elle change, évolue. Si elle n’est pas en mouvement pour suivre cette évolution, elle se retrouve hors du champ d’action économique, hors du foyer sociétal et meurt. Elle doit être sans cesse à l’écoute de son environnement pour orienter sa régénération vers une éco-réorganisation.
Références bibliographiques :
Pour ce témoignage, j’ai pioché principalement dans les ouvrages suivants :
1 : Introduction à la pensée complexe, édition du point no 534
2 : Penser global, Robert Laffont
3 : L’aventure de la méthode, Seuil
La méthode : tous les 6 tomes et particulièrement :
4 : T 5 : l’identité humaine, Seuil
5 : T 6 : L’éthique, Le Point
6 : La voie, Fayard
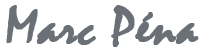





Laisser un commentaire